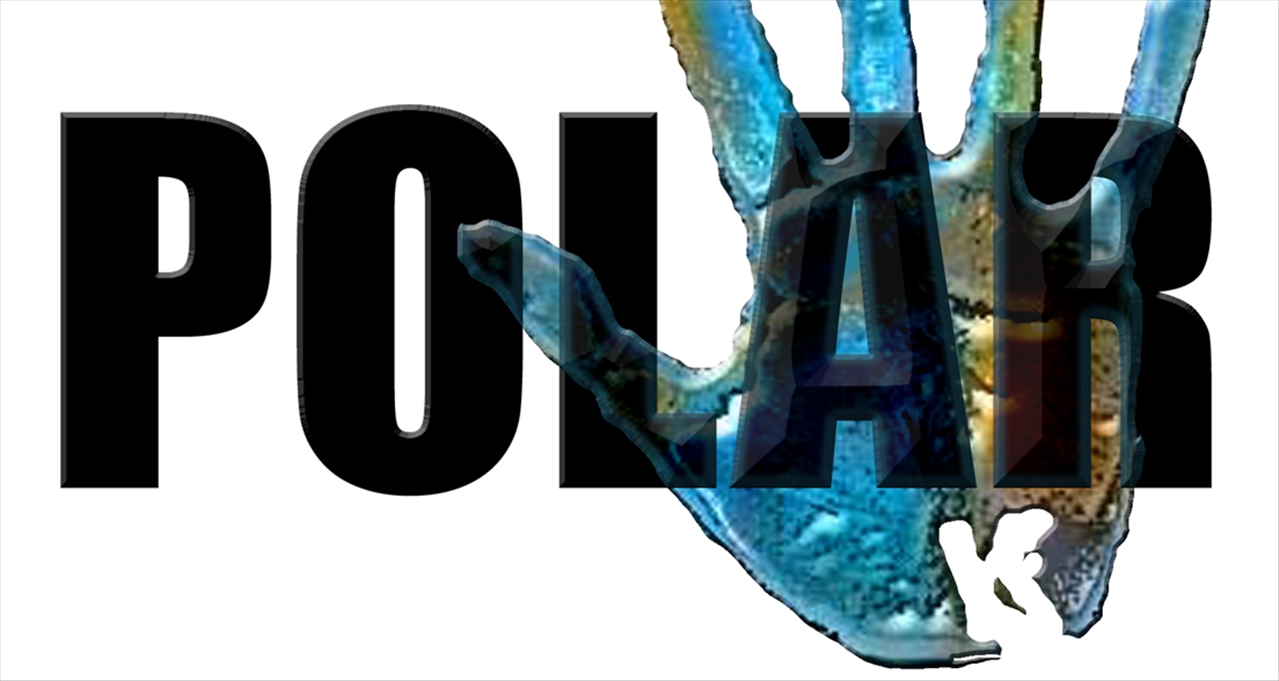Par Raymond Pédoussaut
 Date de publication originale : 2017 (Éditions de la Martinière)
Date de publication originale : 2017 (Éditions de la Martinière)
Genres : Roman noir, sociétal
Personnage principal : Le narrateur, animateur radio
Le narrateur, dont on ne connaît pas le nom, s’estime être « un véritable thermomètre social planté dans la désillusion des hommes. » En d’autre termes il est animateur à la radio, il écoute et fait parler des gens qui ont besoin de s’épancher sur leurs malheurs, sur leurs frustrations. Un jour c’est à son tour de passer du côté des déclassés : il y a restructuration, son émission va être supprimée, il va être limogé. Une de ses connaissances, un baroudeur rencontré dans les Balkans, lui propose une solution : contre trois mille euros, il peut lui donner le temps nécessaire pour imposer définitivement son émission. Pour lui, donner du temps veut dire foutre une bonne dérouillée au liquidateur chargé de virer des gens et ainsi le rendre inopérant pendant quelques mois. Malheureusement le mercenaire a la main lourde, le liquidateur décède. Passé le moment de consternation, notre animateur radio est quand même satisfait de conserver son émission, d’autant plus qu’il n’est pas inquiété pour ce meurtre. D’autres obstacles vont se présenter mais maintenant il a une méthode pour les éliminer.
L’auteur fait d’abord le constat que la violence fait partie intégrante de notre société. On ne peut l’éviter, elle existe quotidiennement. Le héros de cette histoire en arrive à la conclusion : tu te sauveras si tu acceptes la sauvagerie du monde. L’accepter, mais pas forcément la subir. Au contraire il est préférable de pratiquer le même jeu que les prédateurs sociaux, ceux qui décident du destin de milliers de gens sans même connaître leurs existences, dans une tour de Wall Street ou lors d’un conseil d’actionnaires. Pour surmonter l’impuissance et le désespoir il ne nous reste que la violence. Les chemins de la réussite passent par là. La violence sociale entraîne la violence individuelle. Le meurtre, d’abord non voulu, va s’avérer ensuite une solution valable. Du coup notre homme se sent fort et libre. Il s’est hissé au niveau des maîtres du monde.
Le ton est acerbe, le cynisme omniprésent. La démonstration est implacable et d’une grande efficacité, c’est beaucoup plus fort qu’une banale dénonciation de la violence. L’écriture est remarquablement aisée et fluide. L’humour, noir bien sûr, allège la brutalité du propos. Car il faut bien le dire c’est plus avec amusement que désolation que j’ai parcouru ce roman qui peut paraître horrible pour certains bien-pensants. L’histoire semble totalement immorale au premier abord mais elle ne l’est pas réellement, elle a le mérite de montrer à quoi ressemblerait un monde où tous les individus appliqueraient les mêmes méthodes que celles utilisées par les puissants décideurs de ce monde.
Il ne nous reste que la violence est un roman remarquable. Court et incisif.
Extrait :
Je n’avais pas souhaité le décès de Djock, il est vrai. Un bref coma suivi d’une longue période d’hospitalisation m’aurait suffi, mais je ne regrettais pas mon geste pour autant. J’avais accepté cette éventualité avant même de lui donner la pilule. Etre responsable de la mort de quelqu’un ne m’effrayait pas. C’était l’ordre naturel des choses. Nous étions les fourmis d’une longue colonne en mouvement. Que j’en écrase une, ou que je sois moi-même écrasé, ne bouleverserait pas la vie de la communauté. Ou alors pas bien longtemps. Voilà ce que j’avais compris.
Et je me sentais plus fort.
Je m’étais élevé au niveau des maîtres du monde : les dirigeants des États, ceux des entreprises transnationales, les religieux, les chefs des armées et des institutions mondiales, les banquiers, les milliardaires, les mafieux, les terroristes, les mercenaires, les soldats, les traders de Wall Street et de la City… tous ceux qui vivaient au-dessus des hommes et des lois.
Tous ceux qui tuaient froidement, déterminés, en nous regardant dans les yeux et alors on n’osait rien faire.
J’étais libre.
Niveau de satisfaction : 
 (4,5 / 5)
(4,5 / 5)