Par Michel Dufour
 Date de publication originale : 2014 (Alire)
Date de publication originale : 2014 (Alire) 
Genre : Enquête
Personnage principal : Francis Pagliaro, sergent-détective à la Sûreté du Québec
C’est le troisième roman de Richard Ste-Marie. J’ai rendu compte de la version révisée d’ Un ménage rouge le 20 août 2013 et de L’Inaveu le 12 juin 2014. J’aime bien son sergent-détective de la Sûreté du Québec, Francis Pagliaro, passionné de musique classique et de philosophie, bien marié, discipliné et courtois. Un type pour qui la famille est importante comme Brunetti à Venise et Pitt à Londres. Quand un enquêteur est attachant, c’est toujours un bon point de départ.
Dans Repentir(s), Pagliaro et son adjoint Martin Lortie enquêtent sur un double meurtre qui s’est produit à la Galerie Arts Visuels Actuels de Montréal : Gaston ‘’Faby’’ Lessard, galeriste et propriétaire des lieux, et le lieutenant Frédéric Fortier du SPVM (Service de police de la Ville de Montréal); poignardés tous les deux. Pas de lien apparent entre Lessard et Fortier. En fouillant un peu, on apprend que Lessard se mouillait dans des fraudes et des arnaques, et qu’il aidait des motards à blanchir de l’argent. D’un autre côté, Fortier n’était pas aimé par tous les criminels qu’il avait fait condamner mais, en général, on reconnaissait son humanité : un homme bien. Premier problème à résoudre, donc, qu’avaient en commun ces deux victimes?
Ste-Marie nous présente deux histoires en alternance : l’enquête de Pagliaro sur les deux crimes; et l’histoire d’une famille plutôt dysfonctionnelle et de deux jeunes délinquants, au village de Lac-Frontière, une quarantaine d’années avant les meurtres de Lessard et Fortier. D’où le deuxième problème : quel rapport entre ces deux séries d’événements?
Ce qui domine le roman, c’est le récit de l’enquête de Pagliaro par lui-même. Or, comme le dit Pagliaro, le travail de police demeure en bonne part une besogne fastidieuse; rien à voir avec les séries policières télévisées. Lire le déroulement de ce travail, lent et pénible, est encore plus fastidieux : nous ne sommes pas en contact direct avec l’action, mais avec le récit que nous en fait le détective. L’auteur tente d’exorciser cette langueur qui risque de gagner le lecteur par une écriture claire et des informations de première main sur le milieu artistique, particulièrement celui de la peinture : Ste-Marie est lui-même peintre et professeur à l’École des arts visuels de l’Université Laval, et il sert parfois de témoin expert dans des causes de litiges de droits d’auteur et de faux tableaux. Enfin, dans l’histoire secondaire du Lac-Frontière, il introduit quelques scènes incestueuses entre la mère et son fils de douze ans et consacre plus d’une vingtaine de pages à la torture de petits animaux et d’un chat.
Il arrive que de telles scènes soient indispensables pour souligner le caractère d’un personnage : la tendre enfance d’Hannibal Lecter, par exemple. Pas de ça ici : nos deux sociopathes en puissance deviendront d’honorables citoyens. A-t-on voulu illustrer la fonction purificatrice de l’art?
La scène de torture du gros chat sympathique m’a franchement indisposé et son inutilité dramatique a contribué au jugement négatif que je porte sur ce roman. D’autant plus que, lorsque notre policier tire peu de résultats de ses enquêtes, il a recours à ‘une méthode’ plus émotive, intuitive… Heureusement, un beau hasard lui permet d’établir un lien entre les deux récits.
Le réalisme a ses limites et un peu de fantaisie ne gâte pas la sauce : prendre plaisir au film Le Crime de l’Orient Express, c’est très différent que de lire un bon reportage sur les suites de l’enlèvement et la mort de la petite Daisy Armstrong. Et puis, l’enquête est longue, sans surprise, et le suspense tarde à s’installer. Enfin, la scène finale m’a fait penser au temps où je me complaisais à lire Mary Higgins Clark et Guy des Cars.
Des critiques que je respecte, comme André Jacques, Richard Migneault et Norbert Spehner, ont bien aimé le roman de Ste-Marie. Je le mentionne parce que, tout en essayant d’être le plus objectif possible, il peut arriver que des bouffées de subjectivité perturbent ma lecture et faussent mon jugement. Possible que j’aie l’épiderme un peu sensible dans certains cas : les mauvais traitements infligés aux animaux et aux enfants, surtout s’ils ne me semblent pas organiquement liés au sens du récit, me rebutent et me donnent l’impression que l’auteur s’adresse à mes couilles plutôt qu’à mon intelligence.
Extrait :
Pour Pagliaro, le travail de police demeurait en bonne part une besogne fastidieuse : le suivi méthodique de toutes les pistes, ce qui n’avait pas grand-chose en commun avec les émissions populaires de la télévision dans lesquelles les policiers vivaient en dix épisodes plus d’expériences qu’un flic ordinaire n’en vit dans toute sa carrière.
Aucun indice, si ténu soit-il, ne devait être écarté; c’est pourquoi le sergent-détective avait dressé une liste de quatre personnes à interroger cette journée-là.

 (3,5 / 5)
(3,5 / 5) 









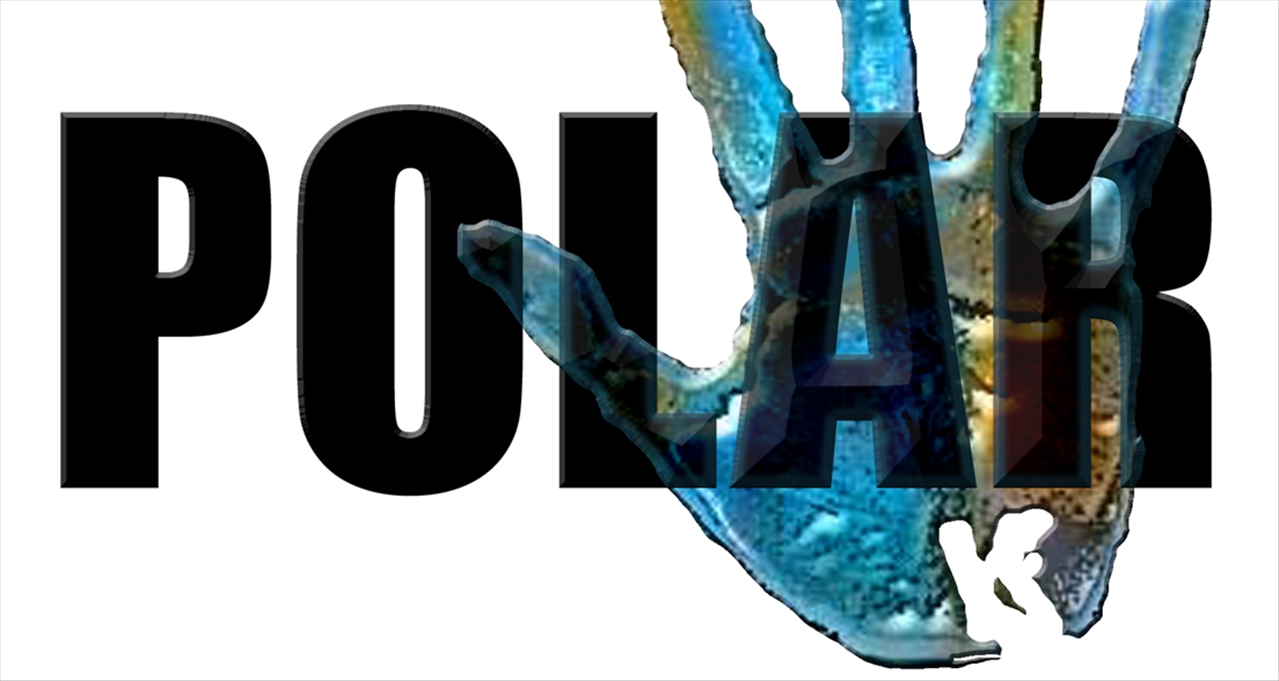


Eh bien, c’est mon jour de contradiction! Je n’étais pas d’accord avec l’avis de Morgane sur Le Cruciverbiste dans Carnets noirs, et voilà que je récidive ici!
Je dois être moins sensible aux psychopathes massacreurs de félins, mais j’ai au contraire trouvé que c’était rafraîchissant d’en voir un qui conserve une certaine sensibilité, laquelle lui permet de vieillir un peu plus sereinement que d’autres.
Quant au récit, sa lenteur ne m’a pas incommodée. L’intuition se nourrit de l’enquête, ce qui me semble réaliste… Et ce Pagliaro philosophe nous change des alcooliques mal embouchés qui pullulent dans les polars courants.
Ce qu’il y a de bien avec la lecture, c’est qu’on y réagit selon sa propre sensibilité, ça fait de belles discussions! Merci de l’avoir amorcée pour nous.
J’aime bien Pagliaro moi aussi, mais il est moins mis en évidence ici que dans les deux premiers romans de Ste-Marie.