Par Michel Dufour
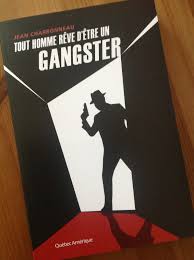 Date de publication originale : 2013 (Québec Amérique)
Date de publication originale : 2013 (Québec Amérique)
Genres : Roman noir, historique 
Personnage principal : Jérôme Ménard, roi de la Main[1]
Jean Charbonneau a étudié la création littéraire à l’Université Southern Mississipi et à l’Université de Boston. Bibliothécaire (en milieu carcéral américain), traducteur, Charbonneau a écrit plusieurs nouvelles en anglais et en français. Ce roman-ci est son deuxième. Écriture souple, informations correctes, rythme lent, andante, adapté au récit où les descriptions des quartiers, des cabarets, des bordels doivent être appréciées pour elles-mêmes. Ce n’est pas une course, plutôt une séquence de petits tableaux en noir et blanc. On traverse des odeurs souvent insupportables et les personnages présentés semblent plutôt inquiétants sans rien à voir, cependant, avec de méchants psychopathes. Le lecteur est emmené à sentir les choses et à comprendre les personnes : comment ça se passait sur la Main, surtout en 1947-48, dans le milieu interlope.
Le fil directeur de ce voyage, évocateur de souvenirs pour un vieux Montréalais dans mon genre, c’est, d’une façon générale, l’épanouissement des enfants Ménard nés à Montréal (faubourg à m’lasse) entre les deux guerres, et plus particulièrement l’avènement de Jérôme comme roi de la Main, grâce au racket de la protection (propriétaires de commerce et même serveurs dans les bars, cabarets et restaurants). Ça se passe du 19 décembre 1947 au 1er février 1948. Des retours en arrière focalisent sur chaque membre de cette famille dysfonctionnelle, mais pas inhabituelle : le père loque humaine dépravée, la mère soumise ou battue, l’aîné Robert qui deviendra accroc à l’opium, Théo qui ira combattre les Boches et en mourra, Jacqueline qui sera serveuse au Débonnaire et se fera pincer les fesses, Estelle placée en orphelinat et qui, à 13 ans, décide de faire sa vie, Georges le balafré, doorman, collecteur, et chauffeur du patron, Johnny Basora (caïd de la drogue, qui a presque toute la ville dans ses poches), et l’entreprenant Jérôme, dont les ambitions finiront par le dresser contre Basora. Ces personnages se révoltent à leur façon contre leur situation misérable : ça nous change du prototype canadien-français catholique, soumis à l’Église et à l’État.
Difficile de ne pas penser aux romans de Maxime Houde qui se passent aussi à Montréal à la fin des années 40. Houde et Charbonneau ont le souci de faire renaître cette tranche de l’histoire quotidienne de Montréal, la musique populaire (de Doris Day à Sinatra en passant par Piaf), la popularité des tramways, le club de hockey Canadiens, et plein d’autres détails pittoresques qui favorisent le fait qu’on croit à cette reconstitution. Charbonneau maîtrise parfaitement le type de langage qui se parlait dans le milieu populaire : les sacres sont bien placés, ce qui vaut la peine d’être signalé parce que bien des auteurs s’y sont cassés la gueule (y compris la pourtant astucieuse Fred Vargas). Mais ce qui signifie aussi que la familiarité de Charbonneau avec cette période chronologique n’est pas artificielle.
Houde, qui tient aussi à l’aspect documentaire historique, compose des ouvrages plus classiques avec un détective paumé, Stan Coveleski, qui mène des enquêtes dans le genre série noire américaine. Charbonneau me semble plus près de la chronique : la vie quotidienne sur la Main montréalaise aux lendemains de la deuxième guerre mondiale. Mais une chronique romancée, ce qui nous vaut une certaine progression dramatique (on sent venir l’affrontement) et une sortie déroutante, imprévisible et bien imaginée.
Original et satisfaisant. Un sens aigu de la modération, qui rend inutiles, malgré le sujet traité, les recours faciles à la violence et à l’érotisme.
[1] – la Main : raccourci anglais de Main Street, rue principale, qui désigne la rue Saint-Laurent entre Dorchester et Sherbrooke (à Montréal).
Extrait :
Le père Delaruelle apostrophe Madame Ménard.
– Je me demandais pourquoi on ne vous avait pas vue à l’église depuis un bon mois.
– C’est pas que je veux pas aller à la messe, mon père. C’est que j’ai été malade. Je crachais du sang…
Le religieux ne semble guère ému. Il pose les yeux sur Georges et Jacqueline et sourit. Les enfants s’agglutinent contre leur mère.
– Et vous savez que priver vos enfants de la messe et des sacrements est un péché. C’est grave. (…) Vous ne pouvez pas vous défiler, insiste-t-il. Et puis, nous avons besoin de votre contribution à la quête.
Madame Ménard tressaille comme si le prêtre l’avait giflée.
– Regardez donc autour de vous pour une fois, mon père. Tous vos paroissiens vivent dans des taudis. Les enfants sont sales et ils ont faim. Les femmes sont au bord du désespoir. Les hommes boivent comme des trous et ils flambent leur salaire dans les maisons de jeux. Les rues sont pleines de robineux et de putains. Et vous, chaque dimanche que le bon Dieu amène, vous êtes là, en chaire, à vous plaindre que la quête rapporte pas assez d’argent. J’en ai plein le dos de tout ça, si vous voulez le savoir. J’en ai plein le dos de ce maudit enfer.


 (4 / 5)
(4 / 5)









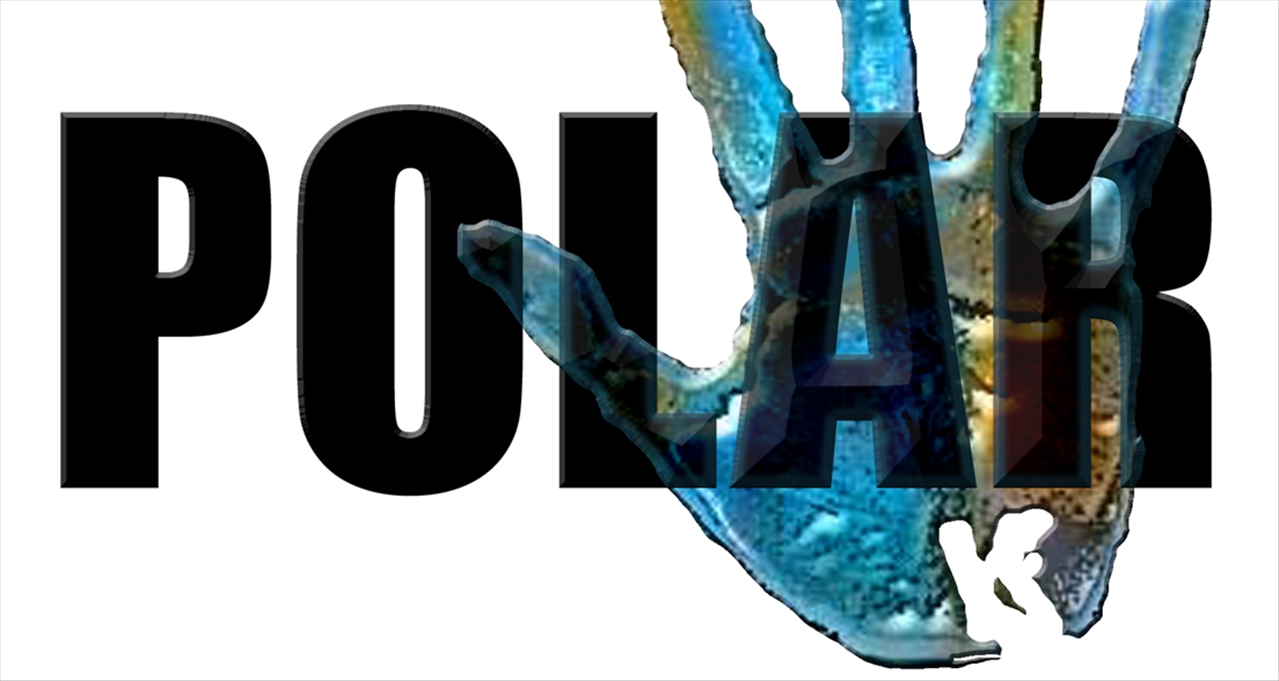


La force de Charbonneau, c’est d’avoir rendu attirante la vie misérable d’une famille aussi dysfonctionnelle. Des personnages touchants.
Fabe, cette chronique est de mon collègue québécois Michel. Je pense qu’il sera ravi d’avoir fait une chronique aussi attirante
C’est un livre qui m’attire. Cela doit faire du bien entre tous mes thriller pour le moment.
Merci à toi pour cette chronique.